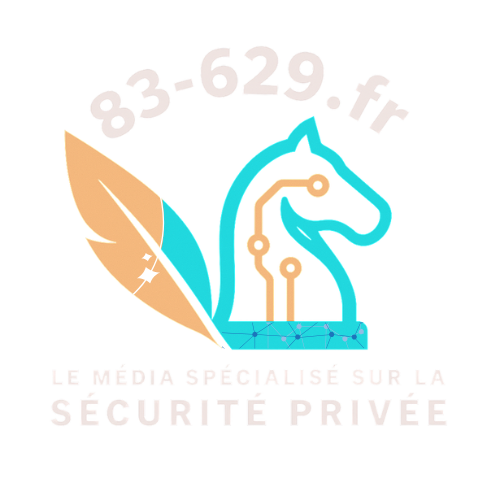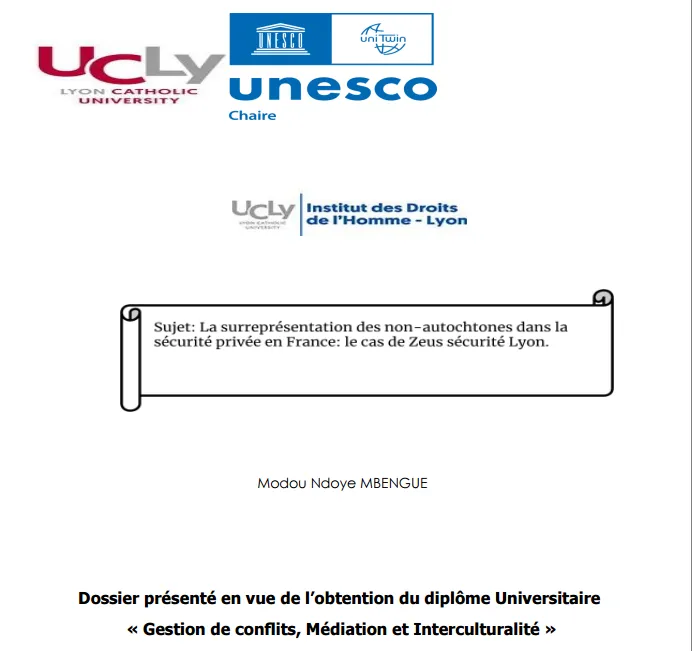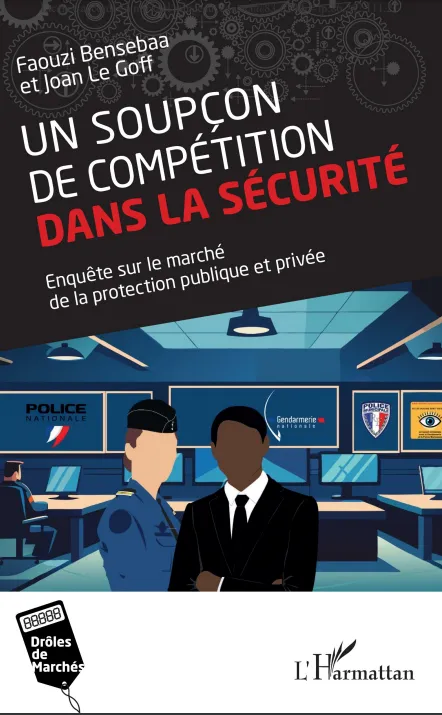Table des matières
- 1. L’Île-de-France concentre 43,6 % des salariés du secteur
- 2. 92 % de taux d’embauche… pour 88 % de départs
- 3. Plus de 7 embauches sur 10 sont en CDD
- 4. Un salarié sur quatre est à temps partiel
- 5. 14 % seulement de femmes dans la profession
- 6. Une ancienneté moyenne de 5,5 ans
- 7. 18 % des hommes ont plus de 55 ans, mais à peine 10,5 % ont moins de 26 ans
- 8. Le CDI est majoritaire (82 %), mais surtout pour ceux qui restent
- 9. La télésurveillance : un autre monde
- 10. La surveillance humaine reste le pilier économique du secteur
- À quand un électrochoc ?
Chaque année, le panorama statistique de la branche « prévention-sécurité » livre ses chiffres. Et cette édition 2023 (diffusé en 2025) ne fait pas exception : derrière les données, c’est un portrait brut, parfois inconfortable, du secteur qui se dessine. Voici 10 chiffres qui, à eux seuls, résument les déséquilibres, les dérives et les réalités souvent ignorées de la sécurité privée.
1. L’Île-de-France concentre 43,6 % des salariés du secteur
Avec à peine 18 % de la population française, l’Île-de-France regroupe près de la moitié des effectifs de la sécurité privée. Rien de nouveau ? Si. Ce déséquilibre continue de s’aggraver, révélant une hyper-concentration des besoins et des moyens, notamment sur fond de marchés publics et de sûreté sensible.
2. 92 % de taux d’embauche… pour 88 % de départs
La rotation est massive. On embauche presque autant qu’on perd. Un effet de portes battantes symptomatique d’un secteur où les conditions de travail, les contrats précaires et le manque de perspectives usent les équipes.
3. Plus de 7 embauches sur 10 sont en CDD
La précarité est la norme. Les CDI deviennent minoritaires. Le message est clair : on vous utilise, mais on ne s’engage pas. Sauf en télésurveillance, où le CDI est la règle. À croire que seuls les écrans inspirent confiance aux employeurs.
4. Un salarié sur quatre est à temps partiel
Et c’est encore pire dans les très petites entreprises, où le temps partiel dépasse les 57 %. Des vacations fractionnées, des horaires instables, et une impossibilité de vivre décemment du métier dans bien des cas.
5. 14 % seulement de femmes dans la profession
Un chiffre qui n’a quasiment pas bougé depuis 10 ans. La sécurité privée reste massivement masculine. Sauf en télésurveillance, où la féminisation atteint presque 30 %. Étonnant, non ? Ou révélateur des conditions de travail plus « tolérables » dans ces postes ?
6. Une ancienneté moyenne de 5,5 ans
La fidélité au poste n’existe plus vraiment. 60 % des salariés ont moins de 5 ans d’ancienneté. Cette instabilité structurelle est un marqueur fort d’un secteur qui n’offre pas de véritables trajectoires professionnelles.
7. 18 % des hommes ont plus de 55 ans, mais à peine 10,5 % ont moins de 26 ans
Le renouvellement générationnel est en panne. Les jeunes n’y entrent plus, ou n’y restent pas. Et ce ne sont pas les contrats courts et les salaires au rabais qui vont les convaincre.
8. Le CDI est majoritaire (82 %), mais surtout pour ceux qui restent
Oui, 8 agents sur 10 sont en CDI. Mais ce chiffre masque une réalité : les jeunes, les femmes, les intérimaires n’y ont pas accès facilement. Et les CDI signés ne garantissent ni temps plein, ni stabilité réelle.
9. La télésurveillance : un autre monde
17 900 salariés, 94 % à temps plein, 98 % en CDI. La télésurveillance échappe aux logiques précaires du reste du secteur. Plus féminisé, plus stable, mieux encadré. Un modèle à part ? Ou une direction vers laquelle tendre ?
10. La surveillance humaine reste le pilier économique du secteur
Malgré la technologie, les drones et les algorithmes, la surveillance humaine représente encore 61 % du chiffre d’affaires. Ce sont toujours les agents, sur le terrain, qui tiennent les sites. Et pourtant, ce sont eux les plus précaires.
À quand un électrochoc ?
Ce panorama 2023 n’est pas une surprise. C’est une confirmation. Année après année, on tolère l’instabilité, on organise la précarité, on sous-paie des agents dont on exige pourtant fiabilité, rigueur et présence 24h/24.
La sécurité privée a besoin d’un sursaut. Pas de communication. Pas d’un plan quinquennal creux. D’actes concrets, sur les salaires, les temps pleins, la formation, la sous-traitance. Il est temps d’arrêter de gérer la sécurité comme un centre de coûts et de commencer à considérer les agents comme des professionnels. Parce qu’ils le sont.